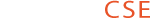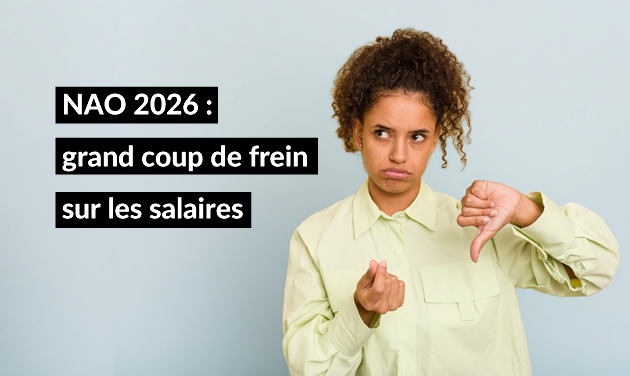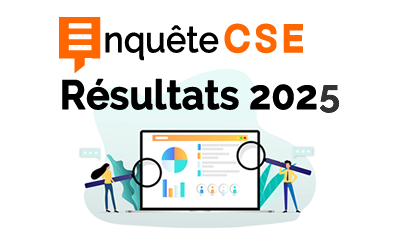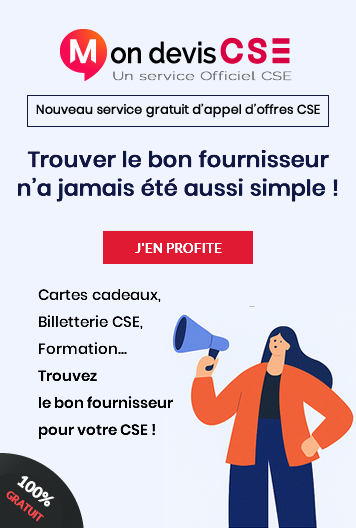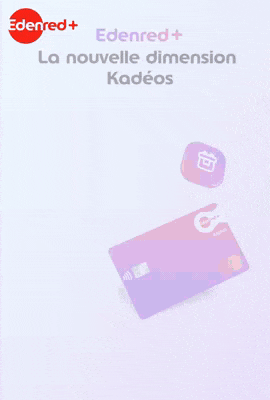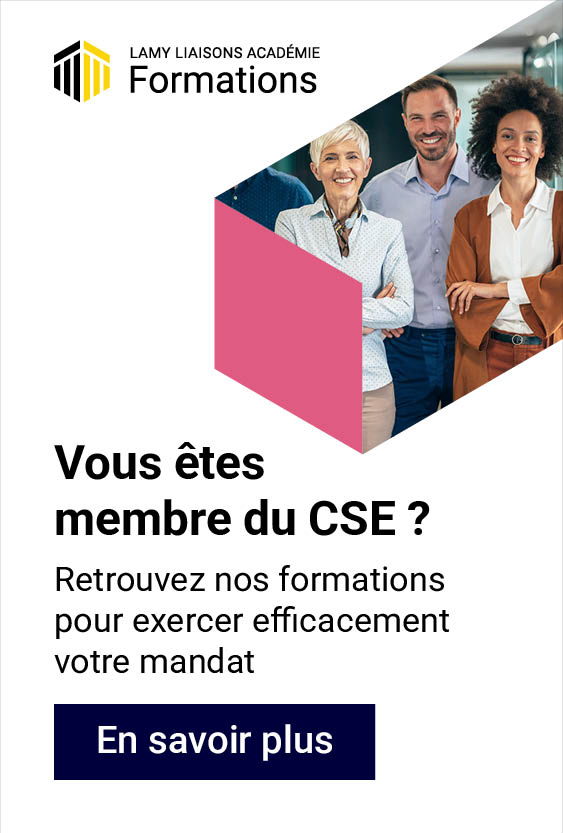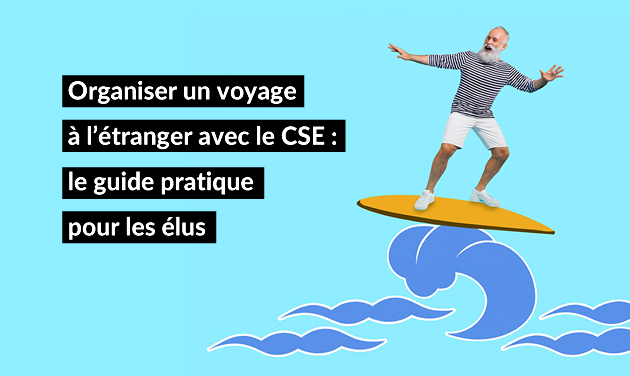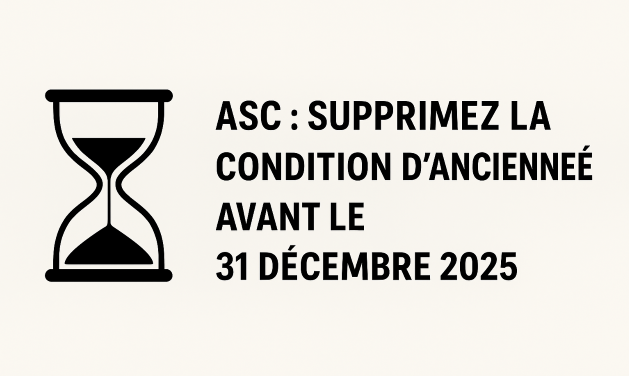
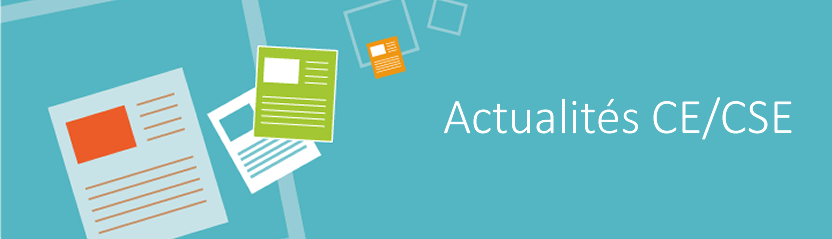
Les prérogatives des CSE se sont enrichies avec la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Depuis lors, comment les élus peuvent-ils agir sur les questions environnementales ? |
 Rubrique en collaboration avec les Editions TISSOT |
Les avancées et les limites
Chaque consultation donne au CSE l'occasion d'interroger l'employeur sur les mesures prises par l'entreprise :
• d'une part pour limiter les conséquences négatives générées par les activités de l'entreprise (principe d'atténuation) ;
• d'autre part pour s'adapter aux conséquences du changement climatique (principe d'adaptation).
Cependant, 4 ans après la promulgation de la loi Climat et résilience, les partenaires sociaux ne semblent pas s'être entièrement emparés de leurs nouvelles missions.
Il ressort de l'enquête « Travail et climat » publiée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) en 2023, que cette difficulté peut s'expliquer notamment par deux points :
• le manque de formation : en effet, la loi ne prévoit pas de formation spécifique sur ce sujet. Tout au plus ce champ peut être intégré au sein de la formation de 5 jours qui existe déjà pour les nouveaux élus ;
• le manque de temps consacré à ce sujet : aucun moyen supplémentaire en temps, voire en budget, n'a été prévu par les textes.
Notez-le : Les répondants pointent également le manque de volonté de l'employeur.
De même, une enquête Syndex/CFDT d'octobre 2023 révèle que les représentants syndicaux interrogés sur les leviers à préconiser pour permettre une transition écologique socialement juste, ils sont 81 % à répondre qu'il leur faut être mieux formés sur les questions environnementales.
Ainsi, faute d'une montée en compétences nécessaire et de temps disponible, de nombreux élus ne se sont pas emparés de ce nouveau sujet.
Quelques pistes pour mieux appréhender le sujet environnemental
Les CSE souhaitant améliorer leur appréhension du sujet environnemental peuvent se référer aux pistes évoquées dans l'ANI du 11 avril 2023 sur la transition écologique et le dialogue social.
Une instance référente
La loi ne prévoit, en effet, ni moyens supplémentaires ni commission spécifique pour traiter des questions environnementales au sein du CSE. Ces points peuvent néanmoins être négociés avec l'employeur.
La création d'un poste de référent ou d'une commission environnement, dotés d'heures de délégation, permettrait de s'assurer que les enjeux environnementaux sont bien intégrés dans chaque consultation du CSE.
Cette intégration peut d'ailleurs se faire à travers un temps de consultation spécifiquement dédié afin d'accroître la visibilité de ce nouvel enjeu (et éviter sa dilution dans une multitude de sujets différents).
Exemple : Au sein d'une entreprise cliente de 450 salariés environ, une commission spécifique a été créée par accord d'entreprise. Cette commission est composée de 6 représentants du personnel et de 4 membres de la Direction. Elle se réunit une fois par mois. Cette commission peut statuer directement sur certains sujets non stratégiques et intervient en CSE, qui reste l'organe décisionnel pour les sujets les plus importants.
Mais ces efforts risquent de se révéler insuffisants sans une meilleure formation des élus. Or, comme nous l'avons vu, le législateur n'a pas prévu de moyens supplémentaires pour cette formation.
Une formation ambitieuse
Il est là aussi possible de passer par le biais d'une négociation préalable soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de la branche, afin d'instituer une formation spécifique et ambitieuse sur le sujet de la transition écologique pour tout ou partie des élus.
Par ailleurs, tout élu dispose d'un congé de 12 jours par an de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Plusieurs organisations syndicales ont développé des modules de formation spécifiquement dédiés à la transition environnementale.
La participation à une formation de ce type pourrait constituer un prérequis aux élus souhaitant devenir référents sur ce sujet.
Enfin, en attendant cette montée en compétences, les élus peuvent d'ores et déjà s'appuyer sur des experts externes comme ils le font déjà régulièrement dans d'autres domaines.
La loi du 22 août 2021 constitue un véritable changement en consacrant cette nouvelle compétence environnementale des IRP. On peut toutefois regretter que les moyens consacrés par le législateur à cette nouvelle mission ne soient pas en adéquation avec les ambitions affichées.
Matthieu Sajno
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.